Georges J. Arnaud, le ponte des glaces
mercredi 16 janvier 2008 à 12:12 :: La série :: Alerter la modération
Depuis
le 22 décembre dernier, KD2A diffuse l’adaptation télévisuelle de La
compagnie des glaces, ce classique de la science-fiction écrit par
Georges J. Arnaud. Cette « machine à écrire » est l’auteur,
sous différents pseudos, de quatre cents romans. Portrait.
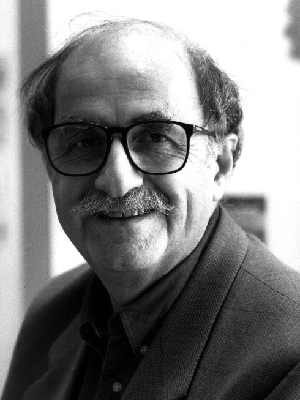
« Pardon ??... Parlez plus fort, je suis un peu sourd
». D’emblée l’homme, joint par téléphone, vous prévient en riant. Passé
ce temps d’adaptation et de réglage de voix, Georges J. Arnaud, né
Georges Camille-Arnaud en 1928 à Saint-Gilles du Gard, se révèle être
quelqu’un de très loquace, vous bombardant d’anecdotes et bien qu’il
faille s’y reprendre à plusieurs fois par moments, la discussion
s’entame et rebondit au gré des petites histoires qu’il vous raconte.
Issu d’une famille modeste, le père est fonctionnaire des impôts et la
mère demeure au foyer, il se passionne très tôt pour la lecture. C’est
grâce à sa sœur, Eliane, qu’il apprend à lire à l’âge de 4 ans. « Toute
ma famille lisait, je suis né dans un environnement favorable. Je me
souviens que ma grand-mère m’avait également fait découvrir des
auteurs. Par exemple, elle voulait absolument trouver Les misérables de
Victor Hugo. C’est comme ça qu’est né mon amour pour la littérature
», se souvient-il. Pas très bon élève à l’école, il n’ose pas
revendiquer son rêve d’être écrivain de peur de devenir la tête de turc
de ses professeurs. Les réactions de ceux-ci, à l’annonce de sa
carrière, lui donnent d’ailleurs raison, « ils ricanèrent tous dans mon lycée d’origine sauf l’un d’eux, mon professeur de français de première, qui fut très enthousiaste
», confirme-t-il. Quand on l’interrogera plus tard sur ses motivations
qui l’ont poussé à entamer une carrière littéraire, honnête, il
répondra sans ambages, avec l’assurance de ceux qui n’ont plus rien à
prouver ou à justifier, « c’est un vieux souhait, j’ai
toujours voulu faire ça depuis l’âge de dix ans. Plus jeune, j’avais
appris qu’un auteur anglais vivait très bien des droits qu’il touchait
grâce à ses écrits, cela m’avait ébloui ». L’appât du gain comme
seule motivation ? Dur à croire bien que cela expliquerait les
quelques quatre cents romans écrits sous une douzaine de pseudos comme
Ugo Solenza, Georges Ramos, Frédéric Mado, Gino Arnold oscillant entre
le polar, la science-fiction, l’espionnage, ou le livre érotique. Une
façon de conserver l’anonymat ? Pas vraiment, plutôt un moyen de
contourner les règles : « les éditeurs ne pouvaient pas se permettre d'aligner deux fois par mois mon nom d'auteur véritable », confie-t-il. Sa production éparse, foisonnante et diverse, il la regrette un peu aujourd’hui : « j’étais payé au forfait, donc je devais écrire un peu n’importe quoi pour vivre
».
Après-guerre, le monde du livre est en pleine effervescence, il existe
énormément d’éditeurs susceptibles de publier les ouvrages. Alors qu’il
continue son cursus de sciences politiques, son père décède. Il se
retrouve sans ressources et dans l’obligation de travailler. Après
avoir emménagé avec sa femme, Madeleine, et s’être marié en 1951, il
mène en parallèle son travail alimentaire de pion et sa carrière
d’écrivain. Celle-ci ne va pas tarder à décoller puisqu’un an après son
union sort son premier roman « Ne tirez pas sur l’inspecteur ».
Premier succès public et critique puisqu’il obtient le prix du Quai des
Orfèvres pour cet ouvrage. Avec le recul, il analyse : « C’est pas le Goncourt, mais à 24 ans, vous avez l’impression d’être le roi du monde. J’ai pris un peu la grosse tête
». Malgré ce succès, sa maison d’édition de l’époque, Hachette, ne le
garde pas et tel un footballeur changeant de club, il trouve un nouvel
éditeur avec l’Arabesque. « J’avais fait la connaissance du
directeur littéraire du Fleuve noir, François Richard. Il m’avait
demandé d’écrire un bouquin d’un million de signes. J’y suis rentré en
1959 ». Professionnel, il joint l’utile à l’agréable et écrit parfois contre-nature : « les
romans d’espionnage me permettaient de produire les romans policiers
qui me plaisaient. J’ai acquis grâce à eux une certaine liberté et une
petite réputation », annonce-t-il avec une pointe de fierté.
Entre son arrivée au Fleuve noir et le début de l’oeuvre « La
compagnie des glaces » s’écoulent vingt ans. Deux décennies durant
lesquelles, ses œuvres vont être adaptées à la télévision et au cinéma.
Le premier livre à bénéficier de la transposition du papier à l’image
est « L’éternité pour tous ». Adapté par José Bénazéraf, le film
laissait déjà présager de la future carrière du réalisateur comme le
raconte, amusé, l’auteur : « Par la suite, il a réalisé essentiellement des films érotiques et il y avait déjà des scènes érotiques dans celui-ci
». Sur la multitude de ses écrits, dix ont été achetés par la
télévision et vingt par le septième art. La vente des droits de sa saga
en 1996 a été un long et fastidieux processus. « Les
producteurs se sont succédés pendant ces années. Je ne me fiche pas du
résultat, mais une fois que vous avez vendu votre œuvre, tant pis pour
vous », concède-t-il un brin désabusé. Un producteur, plus
chevronné que les autres, Dominique Laurent, est venu le voir avec deux
scénaristes. Ensemble, ils ont partagé un déjeuner. Il évoque
rapidement ses souvenirs, préférant insister sur l’aspect culinaire
omettant quelque peu le contenu du rendez-vous : « c’était il y a cinq, six ans, le déjeuner s’était très bien passé, ma femme sait recevoir, elle soigne toujours ses invités
». Ces propos renvoient à tous les processus d’adaptation. Que faut-il
garder ? Que faut-il enlever ? Peut-on remanier et retoucher
le matériau de départ ? Georges J. Arnaud poursuit en rêvant à
voix haute : « J’aurai préféré une adaptation tout public, pas seulement cantonnée à la jeunesse
».
Vingt-cinq ans de sa carrière d’écrivain, voilà ce que représente La
compagnie des glaces pour Georges J. Arnaud. Le premier épisode est
sorti en 1979, le succès fut immédiat. Au départ, comme souvent, il y a
sa femme. « Elle
m’encourageait à écrire sur le fait que je déteste le froid et la
glace. Je ne suis pas fan de science-fiction et ne me considère pas
comme l’un des ses fondateurs. J’ai essayé de donner à mon histoire un
cadre plus contemporain ». Pas spécialement prolixe et emballé, l’auteur s’est laissé prendre au jeu, il le concède volontiers : « au départ, je pensais écrire que trois ou quatre volumes puis l’ampleur du sujet m’a dépassé
». Résultat : quatre-vingt-dix-huit volumes regroupés dans trois
périodes. La première époque, et la plus conséquente, en comprend
soixante-trois. A la suite d’un hiver nucléaire, la terre est plongée
dans une période de régression. Les hommes circulent grâce aux voies de
chemin de fer. La Compagnie, qui gère le réseau ferré, exerce un
pouvoir coercitif et laisse sous tutelle un peuple éprouvant un désir
croissant de révolte. « Ce qui m’intéressait le plus était de
créer une société de récupération. Les survivants savent qu’il existe
sous la glace des trésors technologiques et intellectuels »,
explique-t-il. L’univers qui vient de naître va passionner des
générations de fans. Tous en veulent plus et le font savoir. Les
demandes se succèdent, l’attente se fait de plus en plus pressante,
Georges J. Arnaud prolonge donc le plaisir et réactive la machine à
écrire. Onze spin-off (œuvre qui se déroule dans le même univers de
fiction qu’une œuvre précédente, mais avec des personnages différents)
voient le jour et il clôt la saga avec vingt-quatre épisodes au bout
desquels le soleil revient. En guise de symbole, les personnages
regrettent le temps des glaces comme si lui, l’écrivain regrettait
d’avoir trop écrit. Il le dit d’ailleurs lui-même, « je m’en
veux d’avoir sacrifié le style, d’avoir écrit n’importe quoi, j’aurai
du préserver une meilleure discipline. Cela dit, je demeure très fier
de La compagnie des glaces, de mes polars. Ils ont été souvent primés
et ont reçu des bonnes critiques ».
Aujourd’hui, il savoure sa retraite et avoue n’avoir « plus
envie » d’écrire. Il a bien essayé mais ses premiers jets
s’avèrent peu concluants. Trois ans se sont écoulés depuis son dernier
roman et la coupure se révèle difficile. « Je
m’ennuie un peu, j’étais très organisé dans mon travail. Je me levais
très tôt et je travaillais jusqu’à onze heures, midi. Puis je passais
deux, voire trois heures à corriger ». Au-delà du syndrome de la page blanche, son écriture est moins fluide, ses idées moins motivantes, « cela ne m’intéresse plus
», soupire-t-il. Souvent raillé par le milieu pour sa propension à
écrire beaucoup et en peu de temps, il est fier de la renommée qu’il a
acquise grâce à son œuvre, malgré les critiques. « Beaucoup
d’auteurs se moquaient de La Compagnie… ils disaient que cela ne
correspondaient pas aux codes de la SF. Il y avait un certain ostracisme ». Afin d’illustrer son propos il se remémore son passage chez Bernard Pivot en 1988. « J’y étais allé pour mon éditeur Calman-Levy. Il avait été très suffisant par rapport à moi. Il avait conclu en disant « cette nuit, vous allez nous en faire un autre ». Ce qui m’amuse, c’est que je n’ai jamais eu besoin de Pivot pour vendre », glisse-t-il malicieusement.
Quand il se retourne sur sa carrière, il contemple son œuvre et déclare qu’il a mené « une vie agréable, ce n’était pas un métier, c’était un plaisir ». Cet admirateur de Simenon («
il n’y a pas de pathos dans ses bouquins, ni d’excès. Ce sont des
histoires banales qui paraîtraient ennuyeuses s’il n’y avait pas cette
atmosphère ») peut enfin laisser reposer ses dix doigts puisque
après cinquante-cinq ans d’écriture, ceux-ci ont bien mérité une
retraite paisible…
Benoît Jourdain.



Commentaires :: Ajouter un commentaire
1. Le mardi 29 janvier 2008 à 12:24, par Anonyme
2. Le samedi 16 février 2008 à 11:09, par KREST 13